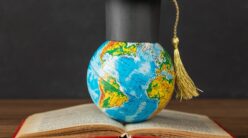Dans les brochures comme sur les bancs, l’entrepreneuriat est partout. L’idée de « créer sa boîte » ne se cantonne plus aux incubateurs de la Silicon Valley, elle s’affiche désormais dans les amphithéâtres des grandes écoles françaises, au cœur d’un discours devenu aussi consensuel qu’attractif. Pourtant, derrière cette promesse d’émancipation par l’entreprise, un flou persiste. Les écoles forment-elles vraiment à l’entrepreneuriat, ou se contentent-elles d’en revêtir les apparats ? Eléments de réponse avec Joris Dutel !
Un engouement massif… et une réponse institutionnelle
Les chiffres ne trompent pas. Pour l’année 2023-2024, plus de 5 800 étudiants ont obtenu le Statut National d’Étudiant-Entrepreneur (SNEE), selon le ministère de l’Enseignement supérieur. De quoi inciter les établissements à enrichir leurs cursus : cours de création d’entreprise, doubles diplômes avec des écoles d’ingénieurs, hackathons à répétition, concours de pitchs, programmes à impact, incubateurs internes et autres fablabs. L’EMLyon parle même d’ »early makers » pour qualifier ses diplômés, quand l’EDHEC et HEC misent sur la vitrine de Station F, temple parisien des startups, pour attirer les profils créatifs.
En surface, tout y est. Mais que se passe-t-il au fond ? Peut-on réellement apprendre à entreprendre sur PowerPoint ?
L’entrepreneuriat comme discipline académique : un paradoxe
C’est là que le bât blesse. Car entreprendre, c’est expérimenter. Se planter, rebondir, convaincre sans garantie, faire preuve d’agilité face à l’incertitude. Or, les écoles sont, par définition, des structures normées, construites autour de grilles de notation, de référentiels pédagogiques, et de contrôles de connaissances. On y enseigne des cas pratiques, mais souvent à huis clos. On y simule des levées de fonds, sans faire appel à un seul investisseur réel.
La théorie reste essentielle. Comprendre les rouages juridiques, les bases du financement, les mécanismes du marketing ou les logiques de croissance est indispensable. Mais l’élan entrepreneurial ne naît pas d’un cours magistral. Il se forge dans l’action, le doute, l’inconfort. Et ces éléments, les écoles peinent encore à les intégrer pleinement.
Un écosystème réservé à une élite
Là où les écoles jouent un rôle clé, c’est dans la mise en réseau. L’accès à un écosystème riche en ressources : mentors, alumni, concours, financements, bureaux partagés. Mais cette richesse n’est pas distribuée équitablement. À Station F, certains projets bénéficient d’un tremplin extraordinaire… à condition de déjà maîtriser les codes, de bien savoir se vendre, de posséder des contacts. Dans la pratique, les écoles reproduisent parfois les inégalités qu’elles prétendent gommer : ceux qui n’ont pas de capital social fort ou de “pitch” séduisant se retrouvent seuls face aux mêmes obstacles qu’en dehors du système scolaire.
La solitude du créateur, la difficulté à recruter, l’absence de fonds et la peur de l’échec sont rarement pris en compte dans les programmes. On célèbre les succès, rarement les renoncements.
Les success stories, un miroir trompeur
Les récits d’anciens devenus stars de la tech ou fondateurs à succès abondent sur les plaquettes institutionnelles. Héros modernes, ils incarnent la réussite méritocratique, l’innovation joyeuse, le « rêve possible ». Mais ces figures cachent une autre réalité : l’immense majorité des projets étudiants n’aboutissent pas. Ils avortent, s’étiolent, ou restent au stade du prototype.
Et cela ne tient pas à un manque de talent, mais à l’absence de confrontation prolongée au réel. Les écoles préparent à une posture entrepreneuriale, à une certaine forme de confiance, mais forment peu à la résilience, à la prise de risque économique ou à la gestion de l’incertitude. Or, c’est précisément là que commence l’entrepreneuriat.
Vers une pédagogie plus immersive ?
Des évolutions sont néanmoins à l’œuvre. Plusieurs écoles remettent en question leur modèle pour proposer des formats plus immersifs. La pédagogie par projet s’impose, les stages de césure deviennent des périodes de lancement de startup, les séjours dans des écosystèmes innovants se multiplient. À l’ESCP, un master spécialisé intègre même un semestre à San Francisco. L’EM Normandie développe quant à elle un programme associant incubation et entrepreneuriat social. Autant de tentatives pour sortir l’entrepreneuriat des bancs et le plonger dans la réalité.